BORDAGE Pierre 01
Auteur célébré pour son triptyque Les Guerriers du Silence (aux très belles éditions de L’Atalante), Pierre Bordage double la mise avec la saga Wang (chez le même éditeur). Déjà détenteur du Grand Prix de l’Imaginaire, des prix Julia Verlanger et Cosmos 2000, voilà qu’il rafle en octobre 1997 le tout nouveau Prix de la Tour Eiffel pour les deux volumes de Wang. Créé par Jacqueline Nebout, présidente de la Société Nouvelle d’exploitation de la Tour Eiffel, et composé d’un jury de 30 personnes, ce prix est confortablement doté (100 000 F !). De quoi donner le sourire à l’écrivain que nous avons rencontré au lendemain de cette récompense. Un auteur d’une grande sensibilité qui nous en dit plus sur lui-même et sur sa création originale…

G. Astic : Une question de circonstance d’abord. Hier, on vous a décerné le Prix Tour Eiffel. Que représente-t-il pour vous ? Est-ce une consécration ?
P. Bordage : Une consécration, sûrement pas. Il y a eu déjà des prix, et c’est plutôt un encouragement à poursuivre. C’est une forme de reconnaissance aussi pour le travail de L’Atalante [maison d’édition nantaise]. Cela me pousse à aller de l’avant encore plus. Le travail d’écrivain, c’est un travail de solitaire et il est vrai que, lorsqu’on a quelques jalons comme ça sur le chemin, on se dit que ça avance peut-être dans le bon sens, donc il faut continuer.
G.A. : À tout nouveau lauréat la sempiternelle demande à laquelle vous n’échapperez pas : pouvez-vous vous présenter et expliquer votre parcours personnel et littéraire ?
P.B. : J’ai la quarantaine, une maîtrise de lettres en poche. À l’Université, j’ai découvert la science-fiction et le plaisir d’écrire, puisqu’il y avait un atelier de création littéraire. Avant d’écrire, quelques boulots. Et puis je me suis remis à écrire en 1986-1987 : c’étaient Les Guerriers du silence. Ensuite, j’ai de nouveau dû travailler, parce que je n’ai trouvé personne pour éditer ce livre. De fil en aiguille, j’ai trouvé les éditions de L’Atalante. Parallèlement à cela, il y a eu les Presses de la Cité qui m’ont permis de faire une série [Rohel le Conquérant, 14 tomes, Vaugirard], importante pour moi parce qu’elle m’a aidé à me structurer en tant qu’écrivain. Depuis trois ans maintenant, je ne me consacre qu’à l’écriture.
G.A. : Comment et où vous situez-vous en tant qu’auteur français de S.-F. ? Le fait même que vous soyez édité chez L’Atalante alors que la plupart le sont chez J’ai Lu, au Fleuve, etc., comment le percevez-vous ?
P.B. : Il est difficile de définir une place. Je crois que L’Atalante m’a pris, selon les propos de son directeur, parce qu’ils ont aimé l’idée de souffle, c’est-à-dire l’idée d’une grande saga épique. Je me revendique assez facilement de la littérature héroïque, une littérature également initiatique.
Le terme de science-fiction m’a toujours gêné parce que je ne suis pas du tout un scientifique, contrairement à Serge Lehman qui se base sur la science pour écrire. Je me situe plus dans une lignée de littérature mythologique ou héroïque. La science est un excellent moyen d’explorer le réel, d’explorer l’univers, mais ce n’est pas le seul. C’est pourquoi je trouve le terme un peu réducteur, car même dans un roman de S.-F., on fait appel à un tas de données qui ne sont pas du tout scientifiques ou très mal maîtrisées par la science (la psychologie, la sociologie, toutes les sciences dites inexactes).
J’essaie, avec les apports de la science moderne, de retrouver l’essence des mythes, la place de l’homme dans cet univers et celle du sens.
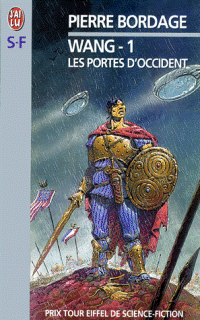
G.A. : Votre prédilection pour les mythes et leur mise en œuvre me font penser aux réalisations de Philip José Farmer, à sa saga autour du fleuve…
P.B. : Oui, Le Monde du fleuve. Probablement que Farmer m’a influencé, parce que c’est un auteur que j’ai découvert à l’université. Je pense à d’autres aussi : Herbert avec Dune, Heinlein – surtout En terre étrangère, un livre qui m’a marqué ; actuellement, il y a un auteur avec lequel je me sens des affinités, c’est Orson Scott Card. Il a une préoccupation religieuse et philosophique permanente dans son œuvre et, finalement, c’est quelque chose qui me parle beaucoup… je me situerais plutôt dans cette lignée-là.
G.A. : Le cinéma laisse-t-il aussi des empreintes dans votre écriture ?
P.B. : Probablement aussi. La science-fiction est une littérature d’images et on est nourri d’images. Le film qui m’a fait la plus forte impression en tant que spectateur, c’est la trilogie Star Wars. Il y avait là une vision, un souffle, qui était derrière cette imagerie – forcenée même par moments. Je ressentais très profondément cette tentative de replacer l’homme dans son univers, avec le côté initiatique.
G.A. : Quels sont vos projets en tant qu’écrivain ou autre ? Songez-vous à travailler, après toutes ces récompenses, à quelque chose de différent ?
P.B. : Je le dis souvent : ce qui commande chez moi, c’est le sujet. Si le sujet exige du souffle, je le laisse aller dans ce sens. Mais, des sujets que j’ai envie d’explorer ne sont pas du tout du même ordre. Cela va déboucher sur des essais en littérature générale. Déjà Wang était différent des Guerriers du silence, puisque c’était une anticipation par rapport à un space opera. Je ne m’interdis aucune forme d’exploration de l’écriture. Je resterai toujours un pied dans la science-fiction, parce que j’aime cette possibilité de dépassement qu’offre la SF, par les projections lointaines dans l’espace et dans le temps. Ce côté-là, je l’adore, je le garde, mais j’ai envie d’explorer d’autres voies.
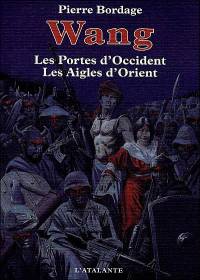
G.A. : Pouvez-vous résumer Wang (Les Portes d’Occident, Les Aigles d’Orient) ?
P.B. : On a un monde occidental refermé sur lui-même, comprenant l’Europe occidentale et le continent nord-américain. Ce monde a créé une barrière infranchissable (dix km de haut, dix km de profondeur). À l’extérieur vit le second monde représenté par plusieurs nations : la grande République sino-russe, la grande Nation de l’Islam, l’Amérique du sud – une sorte de continent livré à lui-même. Le livre raconte l’histoire d’un héros chinois déporté en Pologne, suite à des mouvements massifs de troupes qui se sont écrasées sur le Rideau électromagnétique. Vivant sous la coupe des néo-triades (des mafias mongoles locales), Wang doit fuir, quitter sa grand-mère qui lui a enseigné l’art (le tao) de la survie, et passer en Occident, qui de temps en temps ouvre des portes pour accueillir des flots d’immigrés [d’où le titre du premier tome]. Wang découvre l’Occident de l’intérieur, cet Occident au sujet duquel de nombreuses légendes circulent. Par la suite, à l’intérieur du continent, il est sélectionné dans une armée pour participer à des jeux uchroniques, c’est-à-dire des reconstitutions des batailles du passé. En fait, les nations occidentales se servent de ces jeux uchroniques pour résoudre leurs querelles et leur désir de prédominance. Or, Wang, animé par le tao de la survie, échappe totalement au contrôle de son stratège (français) et lui permet d’ailleurs de remporter les défis.
G.A. : À propos du tao de la survie, cela fait de Wang un personnage de roman initiatique…
P.B. : Complètement. Il y a une mutation du héros. Dans le premier tome, il est dans le tao de la survie, il est l’agent d’une force sous-jacente – surtout développée dans le second tome, un groupe d’hommes hybrides qui tentent d’échapper au continent. Par la suite, passant au tao de la vie, le but de Wang sera d’abaisser le rideau électromagnétique et de neutraliser les satellites de surveillance pour permettre à cette communauté de mutants de partir pour fonder une nouvelle civilisation.
G.A. : Pourquoi avoir choisi Wang, un Chinois ?
P.B. : Question d’affinité et de logique. Pour un immigré qui découvre l’Occident, il fallait forcément que je prenne un non-Européen.
G.A. : Pour écrire ce roman où vous mettez en scène des batailles énormes, Jeux uchroniques obligent, vous êtes-vous intéressé de près à la stratégie militaire ?
P.B. : J’ai voulu le faire, mais je ne l’ai pas fait.
G.A. : Tout vient de l’imaginaire ?
P.B. : En grande partie. Je me suis astreint à être très précis sur l’habillement, sur les costumes, sur l’armement. Comme je me suis intéressé à un héros qui est chaotique – finalement il déjoue toutes les manœuvres, je n’ai pas eu recours à des plans précis de bataille, seulement des manœuvres classiques.
G.A. : Comment vous est venue l’idée d’utiliser des grandes batailles de l’Histoire ?
P.B. : C’est l’idée de base du roman. Elle s’est construite sur des jeux stratégiques qui se serviraient d’individus. Si on remplaçait des pièces du jeu d’échec par des humains, qu’est-ce que cela donnerait ? Si on les faisait s’entre-tuer, quelles seraient les règles ? Pourrait-on maîtriser le jeu ? Tout l’univers de Wang s’est structuré autour de cette idée.
G.A. : Votre roman est-il alors à l’image de notre monde actuel ? Se veut-il référentiel, notamment en regard du duel France/États-Unis (pour la suprématie linguistique et économique) ?
P.B. : C’est assez évident. Au départ, je n’avais aucune théorie. Ce qui est amusant, le roman est parti de cet univers de jeu. La question se posait ensuite : qui allait être utilisé comme guerriers ? Qui accepterait de devenir des soldats de guerres inutiles en fin de compte, uniquement pour une primauté stratégique, sinon des émigrés ou des esclaves ? Tout s’est bâti sur le socle actuel : d’un côté, les mondes riches, de l’autre tous les mondes des exclus et qu’on fait rêver par cette espèce d’Eldorado occidental qui n’existe pas en réalité.
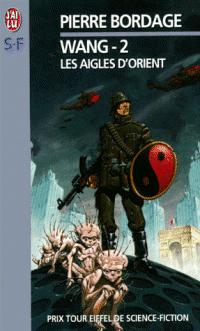
G.A. : Quels sont vos thèmes récurrents ?
P.B. : Un des thèmes forts, qu’on retrouve à la fois dans Les Guerriers du silence et dans Wang, peut se résumer en ces termes : si l’être humain, seul, va au bout de lui-même, il a de grandes chances de mettre en échec tout un tas de stratégies, parce qu’il devient un élément perturbateur incontrôlable. Dans le cas de Tixu Oty, c’est l’amour qui le fait agir ; dans le cas de Wang, c’est la grand-mère et la nécessité de survie.
G.A. : Que conseilleriez-vous aux jeunes auteurs ?
P.B. : Je ferai une réponse en rapport avec mes héros. Qu’ils aillent au bout d’eux-mêmes. Il faut se laisser entraîner par son propre flot et ne pas hésiter à se jeter totalement dedans. En étant le plus collé à ses préoccupations. Ça veut dire ne pas hésiter à s’exposer, à mettre sur la table et dans les mots tout ce qu’on a sur le cœur.
J’ai eu de la chance, d’une certaine manière, quand j’ai débuté. Je ne suis pas un spécialiste de la S.-F. Donc, je n’avais aucun a priori ; je ne me suis donné aucun blocage. Je suis allé au bout de mon idée et ça a fini par payer.
G.A. : Existe-t-il un projet de traduction, aux États-Unis par exemple ?
P.B. : J’ai un ami américain qui s’y essaie. Il a traduit quelques chapitres des Guerriers du silence. Par internet, il tente de contacter des agents américains. C’est assez compliqué, cela suit son cours.
Parallèlement, j’ai le projet de faire une novélisation d’un jeu CD-rom qui s’appelle Atlantis. C’est un projet prioritaire : l’intérêt est que la novélisation sera immédiatement traduite.
G.A. : D’autres projets ?
P.B. : Une fantasy que j’ai commencée pour J’ai Lu. Un space opera prévu pour L’Atalante au printemps. Et un roman de littérature générale que je vais mettre en route cet hiver. J’ai en fait six projets, dont quatre sont pratiquement formalisés. De quoi faire et voir venir…
Entretien recueilli le samedi 11 octobre 1997, au Cyber-Fiction de Cannes.






