Charlton Heston et la science-fiction
Pour les amateurs de science-fiction, Charlton Heston (récemment disparu) restera l’interprète de trois films-cultes du genre : « La planète des singes » (1968), « Le survivant » (1970) et « Soleil vert » (1973).
 Des trois, cependant, le premier (qu’il tourna sous la direction de Franklin J. Schaffner) se détache par la pluralité des questions qu’il pose : son succès, d’ailleurs, sera tel qu’il génèrera plusieurs suites, des remakes et même une série télévisée, toutes productions insipides par rapport à l’original. Ce n’est pas – loin de là ! – que « Soleil vert » manquait de beauté et de conviction. Mais son scénario ne faisait, finalement, qu’amplifier et projeter dans un futur proche des menaces environnementales que personne ne saurait ignorer. Quant au « Survivant », qui allie au thème romantique du dernier homme le problème d’une mutation de l’espèce, il reposait - sans doute trop - sur la seule présence de l’acteur et la noirceur de son canevas ne le prédisposait qu’à un succès d’estime. Cela n’a pas empêché Will Smith de reprendre, en 2006, le rôle clé dans le grandguignolesque « I am a legend », titre original du roman de Richard Matheson qui l’inspira.
Des trois, cependant, le premier (qu’il tourna sous la direction de Franklin J. Schaffner) se détache par la pluralité des questions qu’il pose : son succès, d’ailleurs, sera tel qu’il génèrera plusieurs suites, des remakes et même une série télévisée, toutes productions insipides par rapport à l’original. Ce n’est pas – loin de là ! – que « Soleil vert » manquait de beauté et de conviction. Mais son scénario ne faisait, finalement, qu’amplifier et projeter dans un futur proche des menaces environnementales que personne ne saurait ignorer. Quant au « Survivant », qui allie au thème romantique du dernier homme le problème d’une mutation de l’espèce, il reposait - sans doute trop - sur la seule présence de l’acteur et la noirceur de son canevas ne le prédisposait qu’à un succès d’estime. Cela n’a pas empêché Will Smith de reprendre, en 2006, le rôle clé dans le grandguignolesque « I am a legend », titre original du roman de Richard Matheson qui l’inspira.
Abordons, par conséquent, cette « planète des singes » dont Pierre Boulle, l’auteur du roman éponyme, co-signa le scénario avec, sans doute, le sentiment que le film qui allait en sortir n’aurait plus grand-chose à voir avec son histoire. Ceux qui ont lu l’ouvrage savent, en effet, que les modifications sont nombreuses à l’écran, à commencer par l’hypothèse d’un cataclysme nucléaire pour expliquer cette troublante évolution : S’il faut chercher, dans ce film, une vraisemblance scientifique, ce n’est sûrement pas au niveau de l’astrophysique qu’elle se trouve. Là tout y sonne faux mais ce n’est pas un problème. Dans la science-fiction, la part de la fiction l’emporte de loin sur celle de la science et c’est très bien comme ça. L’hypothèse d’une suprématie du singe sur l’homme par un déverrouillage accidentel du processus évolutif est à peine plus crédible (même si nous partageons avec nos cousins sauvages 98% de notre patrimoine génétique). En revanche, elle ne manque pas de saveur ironique en prenant le contrepied de la vieille thèse darwinienne. Ici, ce serait plutôt le singe qui descendrait de l’homme et tout concourt, dans cette mascarade généralisée, à nous inciter à plus de prudence et de respect vis-à-vis des autres espèces. C’est la leçon relativiste de cette fable cauchemardesque ; leçon commune, au demeurant, à tous les voyages imaginaires depuis l’Antiquité. Quant au modèle social qui est proposé ici, il est manifestement pré-moderne et reprend, en le travestissant, le bon vieux schéma triadique cher à Georges Dumézil. Entre le gorille – voué, cela va de soi, aux tâches policières – et l’orang-outan gardien de la Loi, se trouve le malicieux chimpanzé dont on ne sait trop quel est son rôle exact dans cette société, mais que l’on pressent désireux de se hisser à la première place. Zaius avait de quoi se faire du souci avec de tels subordonnés. Mais quelle que soit la pertinence de son discours, un film – surtout comme celui-ci – vaut d’abord par sa dimension visuelle. Deux scènes, à mon avis, méritent d’être isolées entre toutes ; deux scènes qui condensent un maximum de sens et d’émotion. « La planète des singes » : un film pas tout à fait comme les autres dans sa filmographie.
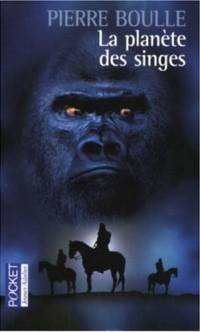 c’était aussi dans l’air du temps. Du reste, son livre contient la matière des deux opus sans envergure qui suivront, « Le secret de la planète des singes » (1970) et « Les évadés de la planète des singes » (1971).
c’était aussi dans l’air du temps. Du reste, son livre contient la matière des deux opus sans envergure qui suivront, « Le secret de la planète des singes » (1970) et « Les évadés de la planète des singes » (1971).
Car ce qui faisait la tension et la grandeur du premier – cette interrogation diffuse mais permanente sur la notion d’humanité – avait déjà sombré dans l’anecdotique et le sensationnel.
Rappelons-en brièvement le canevas. Un vaisseau spatial, parti de la Terre en 1973, emporte quatre cosmonautes vers la mystérieuse planète Bellatrix, dans la constellation d’Orion (l’un d’eux, la seule femme de l’équipage, mourra en route). A leur tête se trouve le commandant George Taylor – Charlton Heston -, personnalité assez désabusée comme on l’apprendra vite. C’est lui qui tient le journal de bord et lorsqu’il rentre dans son caisson de dépressurisation un peu avant « l’atterrissage », le spectateur sait que plus de 2.000 ans se sont écoulés depuis leur départ, puisque le compteur marque 3.978.
 Descente et entrée dans l’atmosphère : le module s’échoue sur la mer, près d’une plage. Aucun des trois astronautes ne doute, pour le moment, d’être arrivé au terme de leur destination. Exploration du territoire puis petit bain récréatif dans un lac. Mais les voici bientôt dépouillés de leurs vêtements et pris en chasse, avec d’autres créatures à forme humaine, par une horde de gorilles à cheval. Blessé puis capturé et mis en cage, Taylor va cependant attirer l’attention de deux jeunes savants aux allures de chimpanzés, Zira (Kim Hunter) et Cornélius (Roddy Mc Dowall). On lui donne même une jeune compagne qu’il baptise Nova (Linda Harrison). Progressivement, il retrouve l’usage de la parole, ce qui le différencie des autres « hommes », tous muets, et le rapproche, non sans les inquiéter, de ses nouveaux maîtres. De là s’ensuivra un interrogatoire drastique mené par le rigide docteur Zaius (Maurice Evans) sur l’origine de cette différence singulière, puis la condamnation de Taylor à la castration et son évasion orchestrée par Zira et Cornélius. Jusqu’à la révélation finale, dans la zone interdite…
Descente et entrée dans l’atmosphère : le module s’échoue sur la mer, près d’une plage. Aucun des trois astronautes ne doute, pour le moment, d’être arrivé au terme de leur destination. Exploration du territoire puis petit bain récréatif dans un lac. Mais les voici bientôt dépouillés de leurs vêtements et pris en chasse, avec d’autres créatures à forme humaine, par une horde de gorilles à cheval. Blessé puis capturé et mis en cage, Taylor va cependant attirer l’attention de deux jeunes savants aux allures de chimpanzés, Zira (Kim Hunter) et Cornélius (Roddy Mc Dowall). On lui donne même une jeune compagne qu’il baptise Nova (Linda Harrison). Progressivement, il retrouve l’usage de la parole, ce qui le différencie des autres « hommes », tous muets, et le rapproche, non sans les inquiéter, de ses nouveaux maîtres. De là s’ensuivra un interrogatoire drastique mené par le rigide docteur Zaius (Maurice Evans) sur l’origine de cette différence singulière, puis la condamnation de Taylor à la castration et son évasion orchestrée par Zira et Cornélius. Jusqu’à la révélation finale, dans la zone interdite…
![]() La première, qui est aussi la dernière dans l’ordre chronologique, est évidemment celle où Taylor découvre avec stupéfaction la Statue de la Liberté en morceaux. Jamais, sans doute, une plage de Malibu – c’est là où elle fut tournée – ne suscita autant d’alerte. Filmé en plongée, Heston (pourtant si imposant) semble tout petit, écrasé par la célèbre tête casquée de rayons que conçût Bartholdi. C’est là qu’il réalise toute l’ampleur de la catastrophe : « Deux mille ans après, nous sommes revenus sur la Terre… Ah, les fous ! Les criminels ! Ils les ont fait sauter, leurs bombes. ». Et de s’effondrer à genoux en martelant le sol de rage. La musique néo-sérielle de Jerry Goldsmith, qui rythmait jusque là les images, s’efface au profit du bruit lancinant des vagues, à l’amble de ses pleurs. Tout est dit et le générique peut être envoyé.
La première, qui est aussi la dernière dans l’ordre chronologique, est évidemment celle où Taylor découvre avec stupéfaction la Statue de la Liberté en morceaux. Jamais, sans doute, une plage de Malibu – c’est là où elle fut tournée – ne suscita autant d’alerte. Filmé en plongée, Heston (pourtant si imposant) semble tout petit, écrasé par la célèbre tête casquée de rayons que conçût Bartholdi. C’est là qu’il réalise toute l’ampleur de la catastrophe : « Deux mille ans après, nous sommes revenus sur la Terre… Ah, les fous ! Les criminels ! Ils les ont fait sauter, leurs bombes. ». Et de s’effondrer à genoux en martelant le sol de rage. La musique néo-sérielle de Jerry Goldsmith, qui rythmait jusque là les images, s’efface au profit du bruit lancinant des vagues, à l’amble de ses pleurs. Tout est dit et le générique peut être envoyé.
![]() Quant à la seconde, elle se situe au début du film, lorsque Taylor et ses deux acolytes commencent leur exploration. L’un d’eux, Landon (Robert Gunnen), se retrouve à la traîne pour vouloir planter la bannière étoilée dans un monticule de sable ; ce qui fait rire aux éclats Taylor lorsqu’il s’en aperçoit. Ce rire-là est certainement l’un des plus libres et des plus décapants que l’on ait pu voir à l’écran. Il exprime tout le ridicule attaché à la notion de conquête. C’était deux ans avant qu’Amstrong et Aldrin ne plantent, à leur tour, le drapeau américain dans le sol lunaire. Quant au citoyen Charlton Heston, jusqu’alors démocrate, il allait rejoindre, quelques années plus tard, les rangs républicains et soutenir publiquement les candidatures de Ronald Reagan et de George Bush. Plus jamais il ne remettrait en question les symboles de son pays.
Quant à la seconde, elle se situe au début du film, lorsque Taylor et ses deux acolytes commencent leur exploration. L’un d’eux, Landon (Robert Gunnen), se retrouve à la traîne pour vouloir planter la bannière étoilée dans un monticule de sable ; ce qui fait rire aux éclats Taylor lorsqu’il s’en aperçoit. Ce rire-là est certainement l’un des plus libres et des plus décapants que l’on ait pu voir à l’écran. Il exprime tout le ridicule attaché à la notion de conquête. C’était deux ans avant qu’Amstrong et Aldrin ne plantent, à leur tour, le drapeau américain dans le sol lunaire. Quant au citoyen Charlton Heston, jusqu’alors démocrate, il allait rejoindre, quelques années plus tard, les rangs républicains et soutenir publiquement les candidatures de Ronald Reagan et de George Bush. Plus jamais il ne remettrait en question les symboles de son pays.








Commentaires
Charlton Heston et la science-fiction
trés beau film et trés beau acteur ils ont étaient fantastique trés bien et trés bonne histoire